Pour émailler le sujet, extrait de roman où est évoqué la mort d'un capitaine allemand sur le toit du PDT à Mauvanne :

.......
Je vous ai raconté comment, descendant de Paris à la Londe pour comprendre le drame mystérieux qui s’était produit là-bas en 1944, je m’étais arrêtée dans une vieille station-service où, trente-deux ans plus tôt un des protagonistes de cette tragédie avait fait halte : Joachim Brenke. Continuant ma route et arrivée à La Londe je m’étais rendue chez l’adjudant de gendarmerie Dorini.
Il avait accepté de me dire ce qu’il savait sur cette affaire : comment Bérénice de Vaujade, héroïne et victime de drame avait accepté, contrairement à sa mère de servir d’interprète aux Allemands qui occupaient La Londe.
Je pense qu’il est temps de reprendre la parole pour relancer l’élan de mon interlocuteur qui, malgré sa volonté de me faire partager le secret, a parfois des difficultés à se livrer.
« Mais alors, comment a-t’elle assumé cette tâche si difficile… »
Et il m’explique que, seule contre l’avis de sa mère, Bérénice l’a complétement assumée, a relevé ce défi avec tout le courage et l’énergie dont elle disposait.
Ce défi était double. Au-delà du rôle délicat d’interprète auprès d’un ennemi et d’un occupant, la jeune femme avait indiscutablement éprouvé une réelle émotion amoureuse en rencontrant Joachim.
La naïve réflexion de sa fille, « il est beau le soldat » l’avait encore plus troublée car, elle ne pouvait oublier qu’elle aussi l’avait trouvé beau.
La surprise de rencontrer un être humain sous l’uniforme du « boche » haï dont elle avait tant et tant entendu parler par sa mère et ses grands-parents -au soir de novembre près de la cheminée de La Londe ou lors des soirées d’été pendant les vacances en Alsace- avait certainement contribué à cette surprise du cœur et des sens. L’excès même du ressentiment familial fondé au fil des guerres sur des morts fréquentes -dont la famille Willsheim n’imaginait curieusement pas que les mêmes morts et les mêmes reproches pouvaient se rencontrer du côté des Allemands- l’avait toutefois un peu prévenue contre cette attitude. En voyant un jour son grand-père lire un livre de Léon Daudet intitulé « la vermine du monde » elle lui avait demandé de quoi il s’agissait, surprise par la violence qu’elle devinait derrière ce titre.
Son grand-père, cet homme si doux contre qui, petite fille, elle venait se blottir dans la douceur des soirs avait relevé la tête, posé ses lunettes et répondu doucement : « la vermine du monde ma chérie ? Mais ce sont les Allemands ».
Cette façon que nous Français avons de nous imaginer que nous sommes toujours les seules victimes est assez surprenante. Ainsi beaucoup de Français reprochent encore aux Britanniques de les avoir abandonnés pendant la deuxième guerre mondiale alors que c’est bien le gouvernement Français qui les a laissés au milieu du gué en juin 1940. Ils se plaignent aussi - à juste titre- des bombardements d’avant la Libération sur les villes françaises- mais ne savent pas ou oublient que les excès de cette libération, ces excès si pudiquement appelés « épuration » ont causé plus de pertes - et dans quelles conditions !- que les bombardements alliés. Ils ne savent pas non plus, ou oublient, que 900 000 soldats Anglais, Ecossais, Gallois et Irlandais sont morts sur les champs de bataille pour libérer l’Europe. Et encore qu’en 1945 les Anglais n’ont pas voulu nous présenter la note des frais de guerre qu’ils ont dû payer eux-mêmes aux Américains au prix d’effroyables difficultés économiques.
Ainsi Bérénice vacillait dans ses convictions en sachant, de tout son cœur et de tout son corps que toutes ces préventions n’avaient pas un sens aussi profond que la solidarité qui devrait toujours unir les humains. Qu’au-delà des uniformes et des rôles « où le sort avait voulu nous appeler » nous étions tous unis dans la même misère ou la même gloire, celle des fils de Dieu.
« Et alors, Monsieur, comment a-t’elle pu, c’est difficile à dire… résister… »
« Oh, quand on connaît Bérénice, c’est très explicable. Elle était l’insolence même. Douce aux petits mais dure aux grands et aux puissants ; c’était par exemple l’amie du « ravi », le simplet comme on dit ici et le soutien discret mais très actif de plusieurs familles du village qui étaient un peu dans la gêne. Mais vis-à-vis de ceux qui avaient le pouvoir, et c’était le cas pour Brenke, provisoirement en tout cas, elle était toujours en position de refus. Et cette fierté, cette insolence ont écarté d’elle toute idée de compromission, fût-elle purement sentimentale, avec celui qui incarnait l’ennemi. »
En l’écoutant je pense qu’elle avait dû vite chasser ses sentiments amoureux naissants. Je la sens très proche de moi, car j’ai tendance à avoir ce genre d’attitude. Par contre si elle est vraiment comme moi elle n’a pas pu s’empêcher, par jeu et par souci d’efficacité, de se montrer aimable et naturelle avec son adversaire, pour le bien de sa mission, pour le bien du village.
Dorini reprit la parole :
« Ainsi, petit à petit, elle a pris en main les relations de l’occupant avec nous. Je n’avais donc plus guère de contacts avec les Allemands et cela m’arrangeait beaucoup. D’autant plus que je savais, en bon gendarme, tout ce qui se passait dans le village et tout particulièrement le départ des jeunes les plus courageux pour le maquis du fait du STO, le service du travail obligatoire qui les a poussés à partir dans les collines plutôt que d’aller travailler en Allemagne, avec un bon salaire certes, mais pour un ennemi détesté et, surtout, sous les bombes alliées. D’autant plus surtout que parmi ces partants il y avait Marius…le mari de Bérénice.
De plus n’y avait pas de problèmes d’ordre public avec la garnison Allemande car les soldats, tenus par Brenke avec une tranquille fermeté, restaient à la coopérative en dehors de leurs missions de garde et de patrouille, si bien que les contacts étaient inexistants avec la population -qui les ignorait avec beaucoup de dignité- et que tout ce qui était important passait par le filtre de Bérénice.
Tout le monde s’en trouvait bien et on se prenait à espérer que, leur défaite prévisible aidant, les Allemands finiraient par se retirer sans que rien ne rompe cet équilibre dont je n’étais pas peu fier car j’en avais été à l’origine. Si j’avais su ! »
« Si vous aviez su ? »
« Il est encore un peu tôt pour en parler ». Tout d’un coup le gendarme s’arrêta et sembla se tasser sur lui-même. Et j’ai craint un moment qu’il ne se ravise et ne veuille plus poursuivre son récit. Je compris alors que, si en apparence il ne faisait pas son âge par sa stature et son maintien, j’avais tout de même en face de moi un homme vieilli et qui, depuis trente ans gardait, seul dans ce village, toutes les clés du mystérieux domaine où Bérénice s’était perdue. Je le sentais maintenant, Bérénice n’avait pas voulu éviter ce qui la menaçait. Elle s’était perdue elle-même. Pourquoi, comment, et que lui était-il arrivé, cela je ne le savais pas encore.
« Et, au quotidien, comment les choses se passaient-elles ? »
« En dehors des cas particuliers, fort rares, où Brenke me demandait de l’appeler pour une affaire sortant de l’ordinaire - je crois que c’est arrivé deux fois en un an et demi, la première pour une livraison commandée à un fournisseur à qui il fallait téléphoner, et la deuxième… La deuxième, non, hélas, il n’y en a pas eu, c’est Bérénice qui y a été spontanément, ce n’est pas lui qui a téléphoné. En dehors de ces deux cas donc, Bérénice passait deux fois par semaine à la coopérative - une heure environ- et venait scrupuleusement me décrire l’entretien. Elle le faisait de façon telle que c’était pour moi un bon moment de détente.
Parce que si les Londais dans leur ensemble avaient su rester dignes, en vrai Provençaux, pudiques sous une exubérance affichée, quelques femmes mal intentionnées et aiguillonnées par la jalousie inondaient Brenke de lettres de dénonciation.
« Ange si vous saviez ! il a reçu une lettre où l’on accuse le curé de lorgner avec concupiscence vers quelques-uns de ses beaux blonds ».
Et je vous passe, Mademoiselle, d’autres choses, encore plus indécentes. Mais rassurez-vous ce fût la même chose après la Libération. Les êtres humains sont méchants lorsqu’ils croient pouvoir l’être impunément.
La fine Bérénice traduisait fidèlement tout ce qui n’avait aucune importance sur le plan militaire. Elle s’attardait sur ce qui ne présentait aucun risque, les dénonciations stupides, les lettres et les factures de fournisseurs qu’elle détaillait avec minutie et, surtout, elle transformait en banalités ce qui était sérieux. Brenke n’était pas complétement dupe et un jour elle était arrivée, riant aux larmes, car Brenke lui avait fait la remarque que traduire « mitraillettes » ramassées la nuit dans un champ par « kartoffeln » était peut-être une « traduction un peu libre » selon ses propres termes.
Elle était complètement inconsciente du danger et, souvent je lui expliquais que Brenke n’était pas seul du côté des occupants et qu’un jour peut-être d’autres que lui, la redoutable Gestapo par exemple, se pencheraient sur son rôle réel, sur cet interprétariat qui servait surtout à cacher ce que les Londais voulaient dissimuler aux occupants.
Elle s’en moquait, allait au-devant du danger, pensant avoir en main la plupart des cartes. C’est vrai qu’en ce qui concerne Brenke elle menait le jeu avec aisance, d’autant plus qu’il se laissait faire.
Car Bérénice avait trouvé son point faible et en jouait : après avoir accompli son travail bénévole d’interprétariat, en toute discrétion et avec honneur, sans rien dévoiler d’utile à l’occupant, elle s’était prise au jeu des questions sur ce qui lui tenait le plus au cœur de Joachim, la musique en particulier et l’art en général. Là, Brenke était intarissable. Elle le faisait parler et parler encore. Pour gagner du temps, certainement, mais, petit à petit, elle prenait goût à ce monde raffiné qui s’ouvrait devant elle : les salles de concert d’Allemagne, d’Autriche ou de Bohème, les femmes en robe de soirée, les valses et les dorures baroques, les musées merveilleux de toute l’Europe qu’il avait visités si souvent alors que son propre horizon se bornait à une rapide visite du Louvre effectuée à treize ans avec sa professeur d’histoire.
C’est ainsi que se déroulaient ces entretiens. Bérénice gardait toujours des distances que Joachim Brenke n’essayait même pas de réduire car elle était pour lui une sorte de divinité parée des qualités d’une Française idéale, mère de deux enfants qui eux-mêmes n’avaient pas le droit de s’approcher de lui, ni depuis qu’un jeudi alors que les petits étaient allés seuls au village il s’était produit un incident inattendu.
C’était le 6 décembre 1943 et les enfants entraient à l’épicerie pour acheter quelques bonbons quand ils croisèrent le chauffeur de Brenke qui venait faire des achats pour le PC de la compagnie. Ce même chauffeur qui avait parlé au fils de la station service de la Drôme. Il les avait laissé entrer puis avait racheté des bonbons et, dans la rue, les leur avait donnés en leur disant que c’était la Saint Nicolas et qu’en Allemagne c’était la fête des enfants. Les petits, ravis de la gentillesse de ce jeune Rhénan qui ressemblait aux garçons d’Alsace qu’ils voyaient pendant les vacances, s’étaient empressés de tout raconter à leur grand-mère. Celle-ci avait faiblement souri, ne leur avait rien dit mais avait mis en demeure sa fille de tout faire pour qu’ils ne s’approchent plus des « boches », l’argument principal étant qu’ils risquaient d’être empoisonnés. « Les Prussiens l’ont bien fait en 1914 » avait t’elle dit à Bérénice avec le plus grand sérieux. Celle-ci ne s’y était pas trompée et avait compris que sa mère était profondément blessée par cette innocente « collaboration ». Elle avait donc fait en sorte que jamais plus les petits n’aient de contact avec les occupants.
En écoutant parler Dorini je me dis que Joachim avait dû certainement rêver souvent de cette femme vive et belle. Ces rencontres bihebdomadaires avaient du être précédées d’attentes pleines de nostalgie. Où il pensait au jour du retour vers son pays, vers sa famille, ses parents si doux dont il était le seul garçon, ses sœurs jeunes ; laissant là à jamais cette femme idéalisée et inaccessible.
Et pourtant Joachim ne repartira jamais.
La mort le rejoint au matin du 15 août 1944 lorsque les obus de navires qu’il ne voit pas encore commencent de tomber sur les blockhaus de Mauvanne.
Jumelles en main, il scrute l’horizon de Porquerolles, monté sur le toit de la casemate de l’Est. Seul à ne pas être à l’abri il est le premier touché.
Face contre terre, son corps tranché par les éclats, ses doigts se crispent au sol.
À ce moment l’Hauptmann Brenke ne sait pas que le Seigneur lui accorde là une dernière grâce : celle de mourir avant le martyre de Bérénice........

















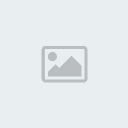 Membre de l'association Fortifications de Marseille et des Bouches-du-Rhône
Membre de l'association Fortifications de Marseille et des Bouches-du-Rhône


















